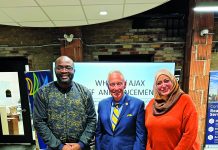Alexia Grousson
À l’automne, les Canadiens prennent un moment pour ralentir, se retrouver en famille et exprimer leur gratitude. Si la longue fin de semaine de l’Action de grâce évoque souvent dinde rôtie, tarte à la citrouille et feuilles colorées, cette tradition puise ses racines bien plus loin que l’image d’un simple repas festif. À la croisée des cultures autochtones, européennes et nord-américaines, l’Action de grâce canadienne reflète une riche histoire de reconnaissance, de survie et de partage.
Bien avant l’arrivée des Européens, les Premières Nations du territoire, qu’on appelle aujourd’hui le Canada, organisaient déjà des cérémonies pour remercier la nature. Selon les nations, cela prenait la forme de festins, de chants, de danses, ou encore du potlatch, une cérémonie de dons et de redistribution, pour honorer les récoltes, les chasses réussies ou tout simplement la fin de l’hiver.
La première célébration officiellement reconnue de l’Action de grâce au Canada remonte à 1578, dans ce qui est aujourd’hui le Nunavut. L’explorateur anglais Martin Frobisher et son équipage organisèrent un repas pour remercier Dieu de les avoir menés à bon port après une traversée périlleuse. Cette cérémonie précède de plus de 40 ans celle des pèlerins américains à Plymouth.
Si les colons français ont, eux aussi, tenu des repas de remerciement pour les récoltes en s’inspirant des traditions autochtones, ce sont les Loyalistes britanniques fuyant la Révolution américaine qui ont véritablement contribué à ancrer cette célébration dans la culture canadienne. Ils apportèrent avec eux de la dinde, de la courge ou de la tarte à la citrouille, désormais incontournables lors du repas de l’Action de grâce.
En 1957, le gouvernement canadien a fixé officiellement la date de l’Action de grâce au deuxième lundi d’octobre, afin de souligner « les bénédictions de l’année écoulée ». Si cette fête a perdu son caractère religieux dans la majorité des foyers, elle reste un moment central de l’automne : un temps pour se rassembler, partager un bon repas apprécier ce moment en famille.
Contrairement aux États-Unis, où la fête est très commerciale et ancrée dans une forte tradition nationale, la version canadienne est plus sobre, moins médiatisée, et axée sur la simplicité : une fin de semaine en famille, des promenades en nature et des assiettes remplies de produits locaux.
Une célébration mondiale sous différentes formes
Bien que l’Action de grâce soit une fête typiquement nord-américaine, d’autres pays ont développé leurs propres traditions autour de la gratitude. Le Liberia célèbre un « l’Action de grâce » en novembre, en mémoire de sa fondation par d’anciens esclaves afro-américains. En Europe, des pays tels que l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse organisent l’Erntedankfest, une fête des récoltes marquée par des processions et des services religieux.
En Asie, la Chine célèbre le festival automnal autour de la pleine lune, avec des danses traditionnelles, des lanternes et les fameux « mooncakes ». Quant à la Grenade, elle a adopté sa propre version de « Thanksgiving » pour commémorer le rétablissement de l’ordre après une période de troubles politiques en 1983.
Quelle que soit sa forme ou son origine, l’Action de grâce reste avant tout un temps de reconnaissance. Dans un monde où les rythmes de vie sont toujours plus effrénés, s’arrêter un instant pour dire « merci » à la vie, à la nature et aux autres, est un geste universel et profondément humain.
Photo (pexels.com) : Incontournable sur les tables de l’Action de grâce, la dinde rôtie s’impose comme le plat favori des Canadiens.